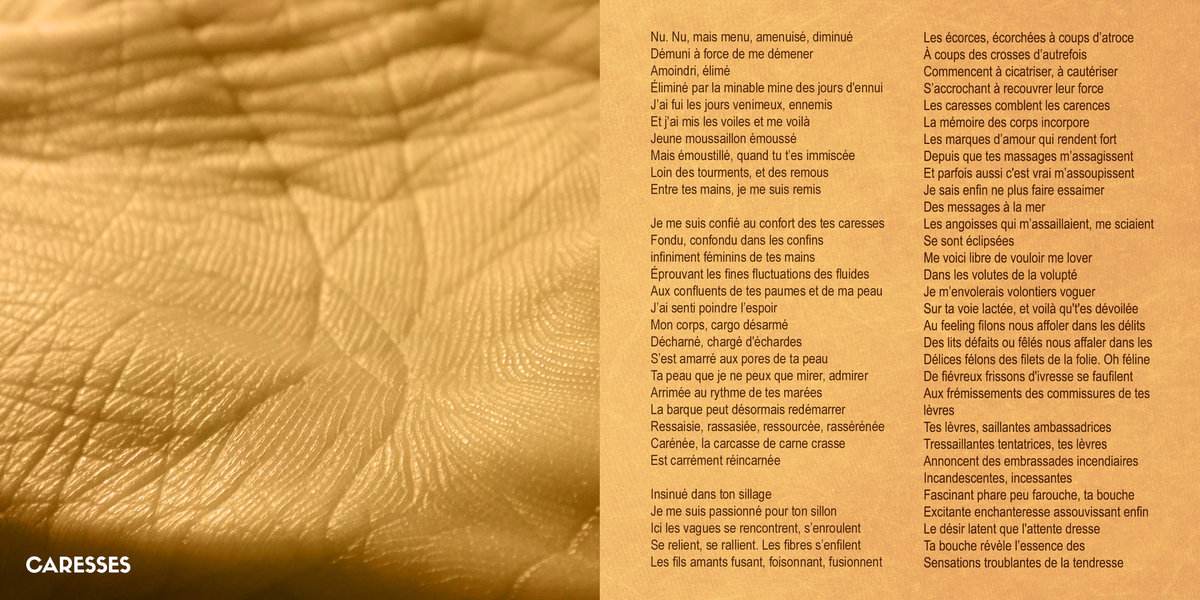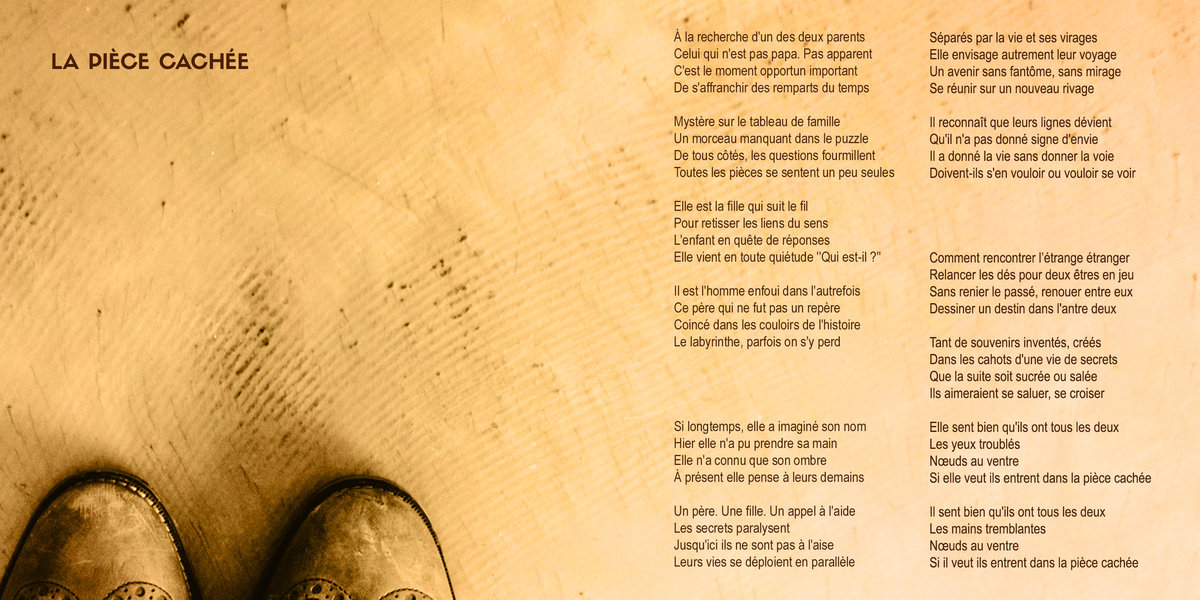Il m’est souvent arrivé de transporter au hasard les étapes successives d’un livre d’une boutique l’autre et de trouver en chacune un paysage nouveau qui l’éclairait de son contraste ou sa coïncidence. Quelque chose de la lecture faîte y demeure, comme les milliers d’empreintes invisibles tapissant les meubles et les murs d’une maison. On ne sait pas qu’en entrant dans une pièce, on les retrouve, menue monnaie spectrale d’heures innombrables. Mais de livres, dévorés ou savourés avec lenteur, l’image sensible revient parfois de loin croiser un jour nouveau, tandis que l’on s’approche sans y songer d’une devanture ou d’un rayon de chemisettes d’été, ou de casiers contenant des chaussettes en fil d’Écosse.
Les
nuances des saisons, elles aussi, éveillent de soudains désirs de
lecture : telle tonalité particulière devient indispensable à
une journée d’hiver où, descendant une rue en pente bordée de
murs derrière lesquels des arbres enneigés veillent en silence, on
voudrait s’installer dans un petit café à l’ancienne, un volume
des enquêtes de Maigret entre les mains, juste derrière une vitre à
rideau vaporeux, donnant sur l’angle de deux rues pavées également
vides. L’après-midi se faufilerait jusque au pelage d’un
crépuscule précoce, dans le seul halètement périodique du
percolateur, l’éclosion progressive des lampes et le furtif
passage de quelques silhouettes à contre blanc. Il ne manquerait
qu’un poêle en fonte et son œil de cyclope, la traversée,
contemplée par les vitres, d’un livreur de charbon, luisant de
prunelles de chat dans le demi brouillard, ou celle d’une jeune
femme en manteau de fourrure comme en portaient les élégantes en
ces ténébreuses années cinquante, hivers sibériens et aux crimes
feutrés derrière les lourdes tentures de fenêtres grises. Comme
des Esseintes revenant satisfait d’un voyage à Londres pour avoir
passé la soirée au café anglais d’une gare bien parisienne, je
serais rentré comblé de cette immobile excursion dans le monde de
Maigret, marchant joyeusement dans la neige fin de siècle, le mince
volume aux pages jaunâtres enfoncé dans ma poche.
Mais
hier, ou plus exactement avant-hier déjà, le samedi 9 août 2014,
entre deux houles d’averses orageuses Le
Voyage d’Hiver
du fantomal début d’année 1993 a soudain rejailli des limbes.
Certes, de temps en temps, le petit livre crème remontait dans ma
bibliothèque au hasard de rangement ou de la quête d’un autre
livre, pour disparaître à nouveau, si bien qu’au cas où me
serait venue l’envie de le relire, j’aurais été bien en peine
de le localiser. Bien des livres, chez moi, voyagent silencieusement
de cette manière, ce qui rend toujours leur recherche hasardeuse,
quelque-fois pénible et vaine, bien que leur poursuite donne
également lieu à l’exhumation d’autres ouvrages oubliés dont
je relis alors quelques pages, debout devant les rayons obstinés à
me refuser le volume désiré.
Avant-hier
donc, devant offrir un livre à des amis qui nous avaient invités à
prendre chez eux l’apéritif, je me trouvai je ne sais plus comment
à la hauteur d’un rayonnage de librairie où figuraient les œuvres
de Perec. Il est d’ailleurs étrange qu’à deux jours de
distance, je ne parvienne pas à me rappeler comment et pourquoi je
me suis avancé vers ce rayon. Je me souviens seulement que mon
intention n’était nullement d’offrir un livre de Georges Perec –
mais voici qu’en rédigeant ces lignes, me revient la raison, je
devrais dire la cause de ma découverte.
Maintenant,
je me souviens.
Faute de trouver les livres auxquels j’avais songé en premier lieu, en entrant dans cette librairie généraliste, j’avais fini par songer à un éventuel André Pieyre de Mandiargues, sans être certain que ce choix conviendrait à nos amis. Mais de Mandiargues, pas la moindre trace. La vendeuse responsable de la littérature française m’apprit qu’on ne pouvait dorénavant se procurer, au moins les œuvres de l’auteur du Musée Noir qu’en les commandant, le nombre des lecteurs potentiels de Mandiargues ayant si sensiblement reflué, comme la mer à marée basse, qu’il était inutile d’exposer des ouvrages que personne n’achèterait et qui seraient par conséquent voués à se détériorer silencieusement dans la solitude peuplée des rayonnages, devenant rapidement invendables aux fantômes qui de toute façon ne les liraient pas.
C’est
ainsi que mon œil s’est porté par hasard sur le rayon consacré à
Georges Perec – pour combien de temps encore, si le curseur des
lectures contemporaines continue de se déplacer dans ce nouveau
siècle amnésique, effaçant au fur et à mesure les auteurs qui
enchantèrent de fervents lecteurs entre 1943 et l’an 2000 ? –
pour découvrir un vaste et haut volume blanc intitulé : Le
Voyage d’hiver et ses suites,
publié en octobre 2013, dont je n’avais jamais soupçonné
l’existence. Quelle n’était pas ma surprise en parcourant
maintenant, chose qu’en principe je ne fais jamais, la quatrième
de couverture de cet étrange ouvrage presque aussi invraisemblable
que les livres utopiques de la bibliothèque de Morphée, dans le
merveilleux et si peu connu Royaume
de Morphée
de Steven Millhauser, lequel vient d’ailleurs de fêter ses
soixante-et-onze ans le 3 août dernier.
Avant
de poursuivre, il est peut-être utile de signaler, même brièvement,
quelques exemples du contenu de cette stupéfiante bibliothèque, si
mon lecteur indulgent m’accorde cette parenthèse à la Jean-Paul
Richter, en échange de quoi je lui fais la promesse de ne pas
m’abuser de sa patience en m’abandonnant comme Jean-Paul à la
tentation des phrases démesurément étendues autour de leur sujet
principal et du récit lui-même où elles s’insèrent, au point de
mériter le nom de périphrases plutôt que de phrases au sens
ordinaire du terme, sachant d’ailleurs que ni les sinuosités
végétales des formulations proustiennes, ni les vibrations d’une
subtilité d’antennes explorant des tonalités spectrales qui
caractérisent le dernier Henry James, comme par exemple dans La
Tour d’ivoire,
ou Le Sens
du passé,
ne s’apparentent aux périodes oratoires chères à Jean-Paul,
lorsque, apostrophant son lecteur, il se livre à quelque exténuante
et savoureuse dissertation où, force est de constater que s’égare
quelquefois la virtuosité de son génie espiègle.
Bref,
la bibliothèque de Morphée, explorée par le héros et narrateur
Carl Hausman, renferme d’innombrables sections dont certaines sont
aussi captivantes qu’inattendues. Ainsi y trouve-t-on les œuvres
de David Copperfield ou de Gustav Aschenbach, dans la catégorie des
livres écrits par des personnages, la version intégrale de Bouvard
et Pécuchet ou celle du Mystère d’Edwin Drood, dans celle des
œuvres inachevées sur terre, mais complètes au royaume de Morphée,
ou encore les soixante-douze pièces perdues et les cent pièces
perdues de Sophocle, dans celle des œuvres égarées, sans parler de
tous les livre projetés qui n’ont jamais été écrits et d’autres
ouvrages infiniment étranges dont je ne dirai rien pour ne pas
épuiser par anticipation le plaisir du lecteur que tenterait
l’aventure de suivre Carl Hausman dans son fascinant voyage.
L’existence réelle de ces joyaux fictifs m’avait moi-même
autant fasciné que l’aurait la découverte d’un filon
d’orichalque ou d’un texte préhistorique gravé au fond le plus
lointain d’une grotte. Rares sont les livres qui savent donner un
tel bonheur à ceux qui s’y plongent, comme si leur substance, une
fois explorée, continuait à l’infini de produire les cristaux
imaginaires de leur énigme poétique.
Mais,
pour en revenir au Voyage
d’hiver et ses suites,
déniché il y a deux jours, qu’elle n’avait pas été ma
surprise de retrouver le mince volume originel devenu le fort livre
de 427 pages dont une postface de Jacques Roubaud, que je tenais
maintenant devant mes yeux. La quatrième de couverture offrait
l’explication de cette métamorphose. Quelques années après la
parution de la micro nouvelle de Georges Perec, Roubaud « avait
éprouvé le besoin d’apporter quelques savants et utiles
compléments au récit perecquien, (…) bientôt suivi en cela par
Hervé Le Tellier, puis, au fil des années par un nombre croissant
d’Oulipiens, chacun s’employant à tirer l’histoire (…) dans
une direction inattendue. Ainsi s’est constitué, autour du texte
de départ, une sorte de « roman collectif » d’un genre
tout à fait nouveau. »
Quoique
peu fasciné, je l’avoue, par les techniques de l’Oulipo, sauf en
quelques cas majeurs où, se dépassant eux-mêmes ils ont donné
naissance à des œuvres majeures, calme blocs luminescents qui ne
trouvaient en ces jeux formels que les moules où couler leur
substance ; Le
Voyage d’hiver
m’ayant enchanté en 1993, et, de même que bien des lecteurs,
laissé orphelin de son énigme, comme si son achèvement avait
paradoxalement laissé sa fin en suspens ; le principe de ses
suites ne pouvait manquer de me fasciner à son tour si bien que,
sans hésitation, avant même d’avoir enfin trouvé ce que j’étais
venu chercher dans cette librairie qui a l’avantage d’être à
cinq minutes de chez moi, je quittais le rayon de la lettre « P »,
le parallélépipède neigeux de ce roman non euclidien entre les
mains.
Il
s’agissait à présent de trouver un livre à la fois digne des
amis auxquels je l’offrirais, sans cependant constituer pour eux un
tel obstacle qu’il rejoindrait la masse des volumes abandonnés par
ceux qu’ils n’ont pas su séduire et dans laquelle, au milieu
d’une matière amorphe, sommeillent aussi de purs diamants
inaperçus. Rien n’est plus difficile qu’offrir un livre à des
personnes que l’on connaît suffisamment pour deviner en elles un
véritable goût, mais pas assez pour être sûr de tomber juste. En
outre, il faut veiller à ce que rien du titre et du récit fasse
allusion à ce qu’on sait des gens auxquels on désire faire
plaisir. De manière générale, sont à proscrire les romans
d’adultère si le cadeau doit être fait à un couple qui bat de
l’aile à cause d’une double vie ou d’aspirations
insatisfaites, les récits comprenant un décès ou seulement un
deuil si le destinataire vient de perdre un proche, les descentes aux
enfers dans le cas des mélancoliques, l’œuvre de Balzac à ceux
qui ne jurent que par la République ou celle de Victor Hugo aux
nostalgiques de l’Ancien Régime. Ô saisons, ô in folios !
Nulle âme est sans petites manies !
Mais,
les livres changeant moins vite que le cœur d’un mortel, il n’est
pas impossible qu’une fois oublié le suicide par pendaison d’un
vieil oncle, l’idée de corde ne finisse par séduire son neveu,
pourvu qu’elle serve un autre but, comme de ficeler un ennemi juré
dans un roman d’aventure, ou se courir plus près de la bordure
intérieure d’un virage, dans un roman sportif tel que l’excellent
Courir
de Jean Echenoz que je n’ai pas lu par manque d’enthousiasme pour
son héros et son sujet.
Reste,
pour demeurer aussi sérieux que j’ai prétendu l’être depuis
les premières lignes de ce petit récrit, que le choix d’un livre
pour autrui, à l’exception de nos intimes, demeure toujours, au
moins pour moi, une sorte de défi dans la mesure où le principe
guidant ma sélection est de n’offrir que des ouvrages qui me sont
chers. Il m’est arrivé quelquefois de renoncer à un auteur ou un
roman dont je craignais absurdement que le destinataire de mon cadeau
ne soit pas digne. Rien n’est pire que d’offrir un livre aimé,
dont le sujet et l’écriture laissent froids ceux qui étaient
censés en être émerveillés, même si l’on a rien avoué de ce
qui le rend à nos yeux si jalousement précieux. Dans une telle
situation, on se trouve pris en pince entre nos sentiments et le déni
de celui que notre trésor a laissé indifférent, comme le serait un
collégien que l’on accuse injustement d’un délit, le menaçant
de sanctions graves, mais dont l’honneur et la fidélité à
l’amitié lui interdisent de dénoncer le vrai coupable. Il m’est
même arrivé une fois dans ma vie, constatant qu’un livre auquel
je tiens particulièrement avait fait l’objet d’un dédain
outrecuidant de profiter d’une visite chez ceux qui l’avaient mis
au rebut, pour le reprendre à leur insu afin de l’offrir à un
lecteur plus méritant.
Dans
la situation présente, il ne pouvait être question de courir un tel
risque, sans pour autant renoncer à mon principe intime. Tout le
problème tenait à la présence des auteurs dont je cherchais une
œuvre. De Millhauser : rien. De Bohumil Hrabal : pas
l’ombre d’un cheveu. Requiem
de Tabucchi : porté disparu. Sir Edmund Orme n’était plus
reparu à sa place légitime depuis des mois, de même que Les
Mystères de Charlieu sur Bar
et plusieurs autres titres restaient inconnus, quand ce n’étaient
pas leurs auteurs remplacés par des cohortes d’imposteurs qui
profitaient d’une similitude de lettre pour s’installer
nonchalamment dans les rayons. Je commençais à désespérer quand,
ayant glissé le regard le long d’une interminable rangée de Paul
Auster, l’idée me vint de me porter à la lettre « H »
de la littérature américaine. Les yeux fermés, j’arrivai avec
crainte à l’endroit précis où, théoriquement, devait se trouver
la merveille qui venait de me revenir à l’esprit. J’ouvris les
paupières : L’Envoûtement
de Lily Dhal
apparut devant moi, avec, en couverture, l’image de la jeune femme
penchée dans un étrange clair obscur à la Georges de La Tour, les
mains posées à plat contre une cloison, de part et d’autre du
miroir ou œil de bœuf dont provient l’aura d’ambre qui fascine
l’inconnue tout en révélant son profil très pur et concentré,
semblable à celui d’une orante fixant l’autre côté de
l’invisible, et digne d’un récit lunaire de Steven Millhauser.
J’avais
enfin trouvé, et c’est à présent d’elle que je voudrais
parler, trois jours après avoir quitté la librairie avec son
envoûtement, Le
Voyage d’hiver et ses suites
et un troisième livre destiné à mon épouse.
Vingt
minutes plus tard, assis dans le métro avec ma femme, le livre que
j’allais offrir à nos amis, posé sur mes genoux, je songeais à
son héroïne. De la mystérieuse image de sa couverture, je ne
pouvais rien voir sous le papier cadeau qui l’enveloppait, mais je
n’en avais nul besoin. Le fin visage plongeant les yeux à
l’intérieur du disque ambré qui l’éclairait, avait surgi de ma
mémoire et se superposait, immobile et captivant, à la vitesse de
la rame dans laquelle nous avions pris place. Il existait, je le
savais, une autre Lily Dhal. Elle se nommait Lénore, et plus
exactement, Lénore Landorova, celle même que l’on rencontre dans
l’introuvable Femme
sans Chambre
de Gérard Mahn. Mais avant d’être un des principaux personnages
de ce curieux roman, Lénore avait été une personne bien réelle
dont toute l’enfance s’était passée à Nice. Ce n’est
pourtant pas dans cette ville que s’est produit l’événement
singulier qu’elle m’a confié l’an passé, tandis que nous
prenions l’apéritif devant la mer, évoquant les souvenirs les
plus marquants de nos années profondes.
La
mère de Lénore comptait parmi ses amis les plus proches le peintre
Jacques Hélios. L’année de ses dix ans, Lénore avait été
malade et n’était pas allée en classe pendant de nombreux mois.
Jacques Hélios, qui était aussi le parrain de la fillette, avait
invité celles qu’on appellerait plus tard à Nice « les
Dames Landorova », à séjourner chez lui, afin que le bon air
de la Corrèze favorise la convalescence de Lénore, idée qui peut
surprendre pour qui connaît la douceur des automnes et des hivers de
la Riviera.
Toujours
est-il que Nadia Landorova et sa fille partirent aussitôt pour
Collonges où elles arrivèrent par une somptueuse après-midi d’été
indien dont les toiles et tapisseries de Jacques Hélios semblaient
des expressions magiques. Le Manoir de Labrunie, avait au soleil de
fin d’après-midi une rougeur de feu que prolongeait celle des
arbres de son parc. Toutes ses fenêtres, illuminées par la chaude
lumière d’octobre, renvoyaient en reflet des fragments du paysage,
comme autant de blasons sylvestres que Lénore s’amusait à
déchiffrer pendant qu’on sortait les bagages de la voiture.
On
ne s’ennuierait pas ! Il y avait là toute une joyeuse
compagnie : Bona et André Pieyre de Mandiargues, Dominique
Brivin, dit Dom le Gaillard car il savait jongler avec des poids de
fonte, Carmen Blin, un auteur franco-britannique de romans policiers
que personne en connaissait, mais qui se montra aussi charmant que
discret, et une ou deux autres personnes dont Lénore n’a pas
conservé le souvenir. L’enfant occupait une vaste chambre donnant
sur l’arrière du parc, son lieu préféré, car il semblait hors
d’atteinte, pays de fées et de brouillards où un étang rêvait
entre les hêtres et les érables. Il était alimenté par une
fontaine en pierre surmontée d’une nymphe endormie que la
tradition du pays appelait « La Belle Morte ». Lénore se
souvenait encore de la première lumière du jour sur le visage
attentif de cette nymphe qui paraissait sortir de son sommeil et
contempler sa chambre à travers vitres et rideaux. De son lit, la
fillette pouvait également contempler une tapisserie de son parrain,
intitulée L’Herbe
des nuits.
Elle représentait une vue du parc. De minces graminées noires
constellées de gouttes de rosée luisantes dessinaient sous les
étoiles des figures d’animaux fabuleux, tout un zodiaque
imaginaire qui venait peupler ses rêves, l’invitant à parcourir
le merveilleux domaine de la nymphe endormie. Sur un autre pan de
mur, un de ces miroirs qu’on appelle sorcières contenait un monde
flottant et flou qui, loin d’effrayer, reposait l’œil pendant
les heures du jour où l’enfant reposait dans le silence, selon les
nécessités de sa convalescence.
Pendant
la fin d’octobre qui fut longtemps très belle et chaude, on fit
quelques excursions, notamment à Vif Argent dont Lénore aimait
faire le tour du lac aux sombres eaux tapissées de feuilles qui
semblaient des gouttes d’or et de rubis ; mais la mauvaise
saison venant, on ne bougea plus guère du Manoir qui ‘enfonça
dans un long hivernage. La plupart des amis partirent les uns après
les autres, et la société se résuma bientôt aux seuls Simone et
Jacques Hélios, à l’exception de Dominique Brivin qui, voisin de
Collonges, venait régulièrement avec sa femme et leur chien, un
grand escogriffe mi-Labrador, mi-Épagneul, qui répondait au nom de
Milou Noir et qu’il fallait surveiller de près car il avait une
fâcheuse tendance à voler les rôtis.
Cette
année-là il se mit à neiger continûment dès fin novembre. Ce
furent alors des jours de lenteur, propices à la lecture, à la
conversation, aux jeux de société, à la rêverie devant les vitres
et leur paysage immobile à force d’infini. Dès quatre heures, la
nuit montait insidieusement du sol, soulevait une vapeur blanche qui
absorbait le parc, puis s’effaçait elle-même dans les ténèbres
vaguement phosphorescentes. Lénore remontait dans sa chambre.
Jacques Hélios allait à son atelier, laissant Simone et Nadia
veiller seules dans le salon. Au cours de cet hiver il peignit
plusieurs toiles représentant des oiseaux fabuleux qui étaient
également des féeries de givre et des constellations. Dans la
journée, Lénore était autorisée à se tenir auprès de lui et
suivre sans un mot la progression des toiles, très lente et
minutieuse, donnant le sentiment que Jacques Hélios les brodait
point par point plutôt qu’il les peignait. Ces oiseaux
fantastiques la fascinaient. Ils lui semblaient des messagers dont la
révélation serait complète et claire le jour où son parrain
poserait la dernière touche. Pour le moment, ils ne se dévoilaient
que partiellement, comme au travers d’un brouillard flou, côte à
côte, chacun dans la fenêtre du tableau qui l’enchâssait.
Lorsque
le temps le permettait, les jours où, brusquement, le ciel se
relevait et se fixait en éclats d’émail, on allait marcher dans
le parc où Lénore s’émerveillait de découvrir sur la neige
quantité de traces subtiles. Elles évoquaient des portées
musicales dont l’enfant s’efforçait de déchiffrer et d’écouter
intérieurement les mélodies environnées de silence. Parfois, quand
le soleil donnait sur les cimes des arbres ou que passait très haut
un fil de bise, on entendait de tout côté un délicat cliquetis de
cristal qui donnait l’impression de circuler dans une forêt de
lustres vénitiens effleurés par un songe.
Arriva
février, qui fut particulièrement froid et splendide. Les nuits
flamboyaient d’étoiles et le gel mettait dans l’espace une
imperceptible vibration dont le moindre toucher éveillait aussitôt
les ciselures.
Le
lac de Vif-Argent qu’on alla voir était d’un blanc de martre
éblouissant. De fines irisations jouaient à sa surface, créant des
illusions de fleurs où circulaient des chats. Déjà, les jours
étaient plus dilatés, comme des pupilles fascinées.
Une
nuit, Lénore s’éveilla soudain. Une clarté d’ambre montait de
la sorcière, formant une impalpable aura. Elle se leva, s’avança,
toucha la surface du miroir où son visage était changé en nuée
mouvante, comme si l’éclairait une chandelle. Cela venait à la
fois de l’intérieur du miroir et de la cloison contre laquelle il
reposait. Elle le saisit avec d’infinies précautions et le retira.
Une ouverture apparut, où se glissait en effet la clarté vivante.
Lénore s’y glissa et se trouva dans une très vaste bibliothèque
qu’elle ne connaissait pas. Elle était certes loin d’avoir
exploré toutes les pièces du Manoir. Elle parcourut de longs rayons
cherchant, la source lumineuse qui ondulait sur le dos des livres,
passait sur elle une main immatérielle, traversait des zones de
ténèbres, effleurait les murs et s’éloignait derrière elle en
direction de sa chambre. Enfin, elle la trouva. C’était une simple
lampe posée sur une table auprès d’un livre. Sur la couverture
blanche, elle lut : Le
Voyage d’hiver,
mais aucun nom d’auteur. Elle saisit l’ouvrage, l’ouvrit et lut
passionnément les premiers mots :
Filigrane
du brouillard.
La
neige en ouvre le jardin.
Voici
cette heure,
Au
très lointain désert ;
Et
la planète est là, qui veille avec l’attente,
Et
montre le chemin, dans la pâleur…
Le
lendemain, très tôt, lorsque elle reprit conscience dans son lit,
elle ne sut pas comment elle était revenue. La sorcière, à nouveau
grise et neutre, avait repris sa place. Lénore se leva, vint à la
fenêtre qu’elle ouvrit. Dans un arbre proche, le premier oiseau de
l’année jetait régulièrement sur le vide la fraîcheur luisante
de son appel. Dans l’étendue de l’avant jour, se révélait le
grain pur d’une étoile, et le monde encore incertain, débarrassé
des fantasmagories, se rassemblait graduellement, tel qu’en
lui-même, à jamais beau en sa simplicité d’énigme nue.
Lyon,
10-14 Août 2014, 13h54
Marc-Henri Arfeux